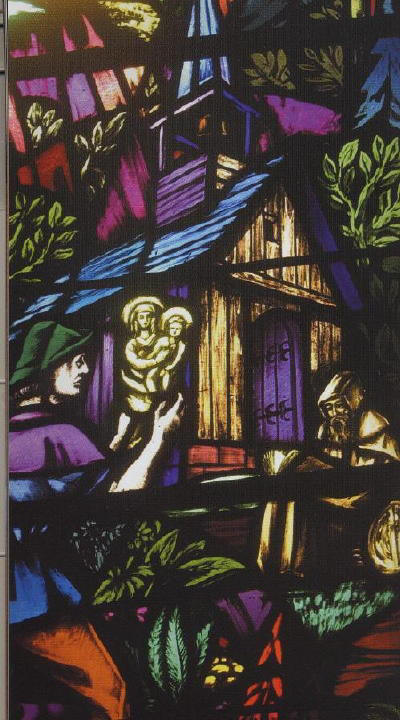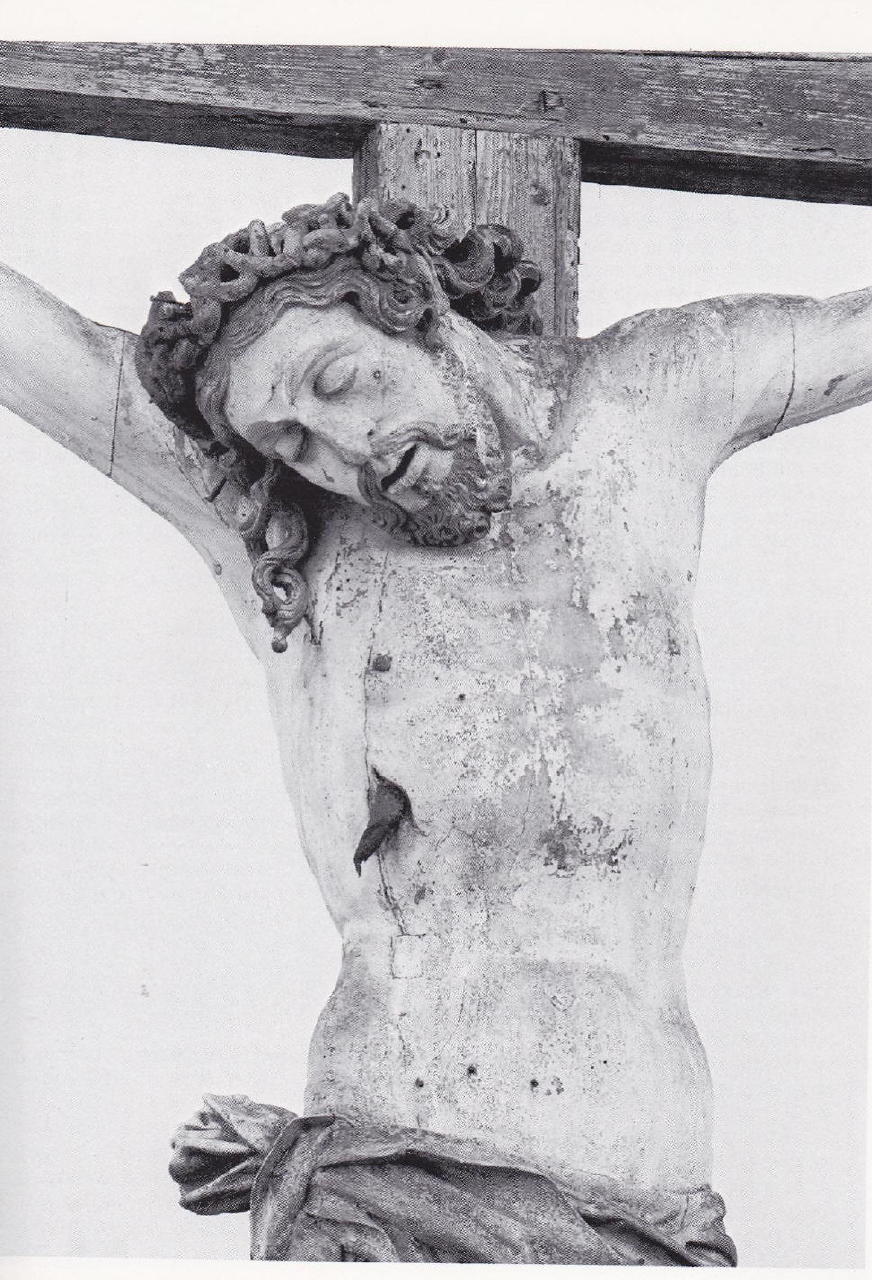NOTRE - DAME DU SCHAUENBERG
Pèlerinage près de Pfaffenheim (Haut-Rhin)
Diocèse de Strasbourg
--
Site. Qui
ne connaît le Schauenberg au-dessus de
Pfaffenheim, entre Colmar et Rouffach ? Qui
ne regarde vers la montagne d'où les
bâtiments et la chapelle rénovés dominent
une partie de la plaine haut-rhinoise?
Le
Schauenberg, en effet, est un beau coin de
la Haute Alsace ; au milieu
d'un paysage favorisé par la nature,
l'histoire et l'art, il est
un Mont Ste Odile en
miniature! Une belle vue très étendue
s'offre au visiteur.
A nos
pieds s'étalent, entourés de vignes, les
villages de Pfaffenheim et
de Gueberschwihr, tous deux bien connus aux
fervents du
style roman: Pfaffenheim, par son ancien
chœur, Gueberschwihr par son clocher, l'un
des plus beaux d'Alsace. - Un peu plus
loin, la petite ville de Rouffach avec son
église "Notre-Dame", vraie cathédrale, ses
vieilles maisons et ses monuments
historiques, puis à perte de vue la grande
plaine, de Colmar jusqu'aux
avant-monts du Jura.
En face de
nous, voici le petit massif volcanique du
Kaiserstuhl et la
Forêt Noire. Par les journées très claires,
on peut distinguer la
flèche de la cathédrale de Strasbourg et,
très nettement, avec la
collégiale de Colmar les "Münster" de Brisach et de Fribourg ;
la vue s'étend même jusqu'aux sommets de l'Oberland
bernois. — Quel beau panorama que celui
qu'offre le
Schauenberg!
Le pèlerinage jusqu'au XVI° siècle. Les premiers temps sont historiquement inconnus, l'histoire, faisant défaut, c'est la légende plus ou moins poétique qui la remplace, mais iIl n'y a pas de doute : la montagne s'appelait Hohburg au début. En 1334 apparaît le lieu dit " Schowenberg " ; un ermite s'y établit vers 1400. D'après la tradition, cet ermite, Udalricus (Ulric), érigea près de l'ermitage une petite chapelle dédiée à St Ulric, très vénéré au Moyen Age. Les habitants de la contrée venaient visiter la chapelle.
D'après des renseignements
authentiques, un miracle se produisit peu
d'années après, miracle qui contribua à la
fondation du
pèlerinage. Une certaine comtesse de Hesse,
sans doute Anne, épouse du landgrave Louis
1° le
Pacifique, était gravement
malade et les médicaments ne pouvaient la
soulager :Dieu lui
apparut et lui fit comprendre qu'elle devait
se rendre avec la
statue de la Vierge, placée dans sa chambre
et très vénérée, à
une montagne dite " Schau-an-Berg ". Elle y
serait guérie. A
peine réveillée de son sommeil, elle se mit
à louer et à
remercier Dieu et la Vierge et chargea
immédiatement un messager d'emporter la
statue et des aumônes, de chercher ladite
montagne et d'y prier en son nom.
Le
messager partit, et après de nombreuses
difficultés, il trouva l'endroit
indiqué où il s'acquitta de son devoir. La comtesse,
elle, fut guérie
miraculeusement et la statue fut placée dans
la chapelle.
A partir
de cette époque de nombreux dévots de Marie
se rendirent au
Schauenberg qui devint un lieu de pèlerinage
et de prière.
En 1483 le chevalier, Hans Erhart de Reinach, collateur de la paroisse
de Pfaffenheim, Hans Rodolphe, son frère,
curé, le prévôt et
les jurés du village s'adressèrent à Gaspard
zu Rhein, évêque de
Bâle, et le prièrent, vu la grande affluence
des fidèles,
d'élever la chapelle du Schowenberg au rang
d'une chapellenie. Lesdits personnages accordèrent au
futur chapelain une rente
annuelle en argent ainsi que des revenus en
vin et en blé ; la
chapelle fut dotée, en outre, de prés et de
vignes. Le chapelain
devait habiter Pfaffenheim, célébrer deux
fois par semaine le
Saint Sacrifice à la chapelle et y chanter
une grand'messe aux
fêtes de la Vierge. Il devait toucher
l'offrande de l'autel, le reste
devant être destiné à l'embellissement de
la chapelle. Le curé
aurait le droit de présenter le chapelain à l'évêque, mais on
donnerait la préférence à un prêtre
originaire de Pfaffenheim ou y ayant
de la parenté.
L'évêque de Bâle accueillit la demande en
fondant la
chapellenie. Jean Hubschinhans en fut le 1er
chapelain. Néanmoins, on
cite encore plus tard la présence d'ermites.
Le manuscrit avec la pétition en vue de
l'érection en chapellenie avec la réponse
favorable de l'évêque de Bâle se trouve
encore aux archives de la paroisse de
Pfaffenheim. Ce précieux document fut déposé
en 1984 aux archives départementales de
Colmar après les festivités du 5° centenaire
commémorant solennellement cet évènement en
présence de Mgr Hänggi, ancien évêque de
Bâle.
La statue miraculeuse. La toute première statuette, celle du temps
de l'ermite, a disparu.. L'évêque de
Strasbourg Jean IV de Manderscheidt
Blankenheim
(1569—92) venait régulièrement en pèlerinage
en ce lieu quand il séjournait dans son
château d'Issenbourg à Rouffach. des lettres
d'avril 1590 témoignent de son indignation à
la nouvelle que la statuette originale avait
disparu du pèlerinage et était remplacée par
une autre sculptée sans doute par un artiste
de Colmar et dont la beauté fut rehaussée
par un peintre pour la rendre plus conforme
au goût du simple peuple d'alors. Cette
petite sculpture fut placée par les
Franciscains, en 1695, sur l'autel principal
dans une niche splendidement nickelée. De
part et d'autre de la Vierge assise avec
l'Enfant, on remarque les figures de St.
François d'Assise et de St. Antoine de
Padoue. Le petit autel fut un don de
François Joseph de Schauenburg (+1738) et de
Marie-Reine Antoinette de Montjoie Vaufrey,
son épouse, décédés tous deux au château de
Herrlisheim et enterrés dans cette localité.
Ce fait explique les armes des nobles de
Schauenburg et de Montjoie (Froberg) ainsi
que la couronne centrale au petit autel. Ce
dernier fut probablement sculpté par Antoine
Werlé, originaire de Guebwiller qui, grâce
aux nobles de Schauenburg travailla
également à Thierenbach, aux autels latéraux
de Soultzbach où il posséda une maison
encore conservée et où il mourut le 19 déc.
1756. La représentation de la toute première
statuette a été trouvée en 1976 dans un
bréviaire du XVIème siècle dans la
bibliothèque au grand séminaire de
Strasbourg.
Essor du pèlerinage à partir du XVIème
siècle. La reconnaissance
officielle du pèlerinage par l'Evêché de
Bâle lui valut un nombre grandissant de
pèlerins. En 1515 il fallut agrandir la
chapelle; c'est sans doute à cette époque
que remonte le choeur gothique orienté vers
l'est. Plus tard se forma la légende d'après
laquelle le diable, voyant la chapelle en
construction, aurait jeté un rocher sur le
petit sanctuaire. Mais le rocher devint
tendre et le plan diabolique échoua. Le
rocher, dit "rocher du diable", existe
toujours et le peuple croit reconnaître dans
ses excavations les doigts du démon. D'après
une autre légende, le diable aurait voulu
faire obstacle à la construction d'un chemin
au Schauenberg en y roulant sans cesse des
blocs de rocher pour empêcher les pèlerins
d'y monter pour prier. Cette dernière
légende est bien significative pour un temps
où l'on expliquait surtout en image. On
appelle le diable »le Malin«, c'est
celui qui vient par derrière, en cachette,
nous mettre des pierres sur la route pour
nous empêcher de monter, de faire le bien.
Cette image du diable répond bien plus à la
vérité que la représentation d'un diable
hideux, cornu net fourchu...
A nouveau, la chapelle s'avéra trop petite.
Il
fallut, en 1685, entreprendre la
construction d'un édifice plus spacieux,
érigé dans le style du
gothique finissant. Par suite de
transformations successives ultérieures, le
style n'apparaît plus nettement. Le projet
de construction
ne put être mené à terme, et la chapellenie
avait même disparu
pendant les guerres du XVII° siècle. On
confia alors le
Schauenberg aux Franciscains de Rouffach.
En 1690,
Christophe Pries, gouverneur du Mundat
Supérieur, territoire
de l'évêque de Strasbourg, le curé Pipion de
Pfaffenheim
(originaire de Rouffach) et le P.
Polychronius Blest, gardien du Couvent
Ste Catherine à Rouffach, soumirent une
demande à Guillaume
Jacques Rink de Baldenstein,
évêque coadjuteur de Bâle. Les
Franciscains du Schauenberg devaient rester
sous
l'obédience du Couvent de Rouffach ; au
moins deux Pères, un Frère et
un domestique devaient habiter le
Schauenberg. Les
Franciscains devaient assurer le service
religieux du pèlerinage, tandis que
la Fabrique de l'Eglise pourvoirait à
l'entretien de la chapelle.
La commune, elle, en devait achever la
construction, mais se
réserver tous les droits au Schauenberg en
cas de départ des Franciscains à la suite
d'une guerre ou de troubles quelconques.
Ainsi fut tranchée la question matérielle
des Franciscains.
Les bâtiments ne devaient pas être
entretenus par la commune.
Ce projet
fut accepté, car dès 1690, le pèlerinage fut
confié aux
Franciscains de Rouffach. Ceux-ci
entreprirent d'achever les
travaux de l'édifice en se faisant ouvriers.
Le 11 juillet 1695,Gaspard
Schnorff, évêque coadjuteur de Bâle, procéda
à la bénédiction
de la chapelle qui contenait quatre autels :
l'autel principal
dédié à la Vierge de l'Assomption, l'autel
de St Joseph, celui de
St François d'Assise et St Antoine et celui
de St Ulric. L'autel de
la Vierge miraculeuse remonte à cette même
époque. Sur
l'emplacement de l'ermitage, les
Franciscains construisirent les
bâtiments conventuels qu'ils occupèrent au
printemps 1704.Plus tard, ils érigèrent le
mur de soutènement qui tient la terrasse de
la chapelle et qui fut terminé en 1780.
Gardiens fidèles du
pèlerinage, ils favorisèrent non seulement
le Schauenberg, but des
pèlerins, mais contribuèrent également à la
vénération de la
sainte Croix en érigeant un chemin de croix
le long du sentier
menant à la montagne. Bientôt le
Schauenberg connut une expansion rapide et
florissante,
grâce à la compétence et à la piété des Franciscains.
Malheureusement, lors de la Révolution, la
chapelle fut interdite au culte, et en 1791
les Franciscains quittèrent les lieux.
Après les
tribulations de 1791- 99. Fin février 1793,
le Schauenberg fut
vendu par le Gouvernement comme bien
national pour 1680
livres. Quatre bourgeois de Pfaffenheim :
Antoine Runner, Sigust, Flesch et André Boesch acquirent
les bâtiments dans
l'intention de les restituer, la Révolution
passée. Ainsi la chapelle fut sauvée,
même si l'intérieur fut pillé
par certains révolutionnaires
fanatiques. Plus de vingt ans devaient
s'écouler pendant lesquels
la chapelle délabrée fut déserte : les
mauvaises herbes poussaient
au lieu béni, les intempéries firent leur
œuvre. Mais la paix
religieuse rétablie, le vœu de tant de
fidèles put se réaliser :
le 1er mai 1810, ceux qui avaient sauvé le
Schauenberg
firent don du sanctuaire et des bâtiments à
la commune de
Pfaffenheim à condition que ce lieu servît à
nouveau de pèlerinage.
La commune devait dorénavant entretenir le
Schauenberg ; en
réalité, ce fut surtout la Fabrique de
l'Église, soutenue par les
pèlerins, qui le prit en charge.
Grâce aux généreux donateurs des villages d'alentour, la chapelle fut réparée et le petit sanctuaire rendu au culte. Le 3 sept. 1811 fut une journée d'allégresse pour toute la région à l'occasion de la translation solennelle de la statuette en son lieu de culte; des prêtres et des laïcs en très grand nombre étaient venus de près et de loin ; ce fut la plus belle des fêtes de son histoire et elle fut commémorée chaque année par une procession.
Le
Schauenberg au XIX° siècle. Le Schauenberg
prend un essor
magnifique, car on continue à le restaurer
et à l'embellir. Les villages
avoisinants y organisent des processions. Un
moment donné, on
projette même la fondation d'une
chapellenie. Grâce aux époux
Antoine Kueny et Marguerite Riss un nouveau
chemin de croix
remplace l'ancien, détruit pendant la
Tourmente. Une partie des
bâtiments vides fut occupée par le
garde-forestier en 1831 sous l'oeil
bienveillant de la commune et à la condition
que le pèlerinage n'en souffrît pas; l'autre
partie, l'ancien couvent fut réservée au
sacristain. Après
1860, alors que Mr. le Curé J. B. Edel
desservait la paroisse de
Pfaffenheim, la chapelle fut embellie et on
érigea le Mont des
Oliviers.
Les vitraux du chœur, sortis des
ateliers de l'artiste-peintre
Weckerlin de Guebwiller, furent payés par
le Curé
Lichtlé, originaire de Pfaffenheim. Les
vitraux du côté gauche représentent l'un, la
Vierge écartant du monde la mal, la guerre,
l'hérésie, la famine et la peste, l'autre la
Vierge attirant les bienfaits sur l'Eglise,
la famille, la patrie et les fruits de la
terre. Ceux de droite montrent l'un, la
guérison de la comtesse de Hesse, l'autre la
translation de 1811, la pierre du diable et
la chute de la jeune fille de Rouffach.
Pendant la guerre de 1870-71, le Schauenberg risqua à nouveau d'être détruit. Deux compagnies de francs-tireurs étaient concentrées à Gueberschwihr et à Pfaffenheim en octobre 1870. Les troupes allemandes, ayant été renseignées, essayèrent en vain d'en faire leurs prisonniers. Gueberschwihr ayant été occupé, les francs-tireurs se retirèrent au Schauenberg d'où ils prirent sous leur feu les soldats allemands. Mais ceux-ci ouvrant un feu d'artillerie très violent, le Schauenberg fut sérieusement endommagé avec sa chapelle et ses bâtiments. Le souvenir de ce combat (30 octobre 1870) a été perpétué par un vitrail dédié par la commune de Gueberschwihr. A la fin du XIX° siècle on entreprit différents travaux à l'intérieur et à l'extérieur de la chapelle.
Le pèlerinage au XX° siècle. Après une restauration complète de la chapelle, du chemin de Croix et du Mont des Oliviers, ce furent le 4 septembre 1911 les fêtes grandioses du centenaire de la Translation de la statue miraculeuse. Dès la veille une procession aux flambeaux ouvrit les solennités ;le lendemain, dans sa parure de fête, Pfaffenheim, en présence de Mgr. Zorn von Bulach, coadjuteur de Strasbourg, porta solennellement la statuette au Schauenberg ; le souvenir de cette fête est resté longtemps vivant.
Le 15 mars 1912, un incident jeta la consternation parmi la population : la précieuse statuette fut volée ; mais 2 jours après elle fut retrouvée par les enfants de l'école.
Pendant la 1ère guerre mondiale le Schauenberg fut épargné malgré la proximité relative du front et attira d'innombrables dévots de la Vierge qui venaient se mettre sous sa protection. Le nombre de ceux qui après 1918 et 1945 vinrent la remercier ne fut pas moins imposant.
En 1947 un nouveau retable, sculpté par l'artiste Saur d'Oberhergheim, fut placé dans le chœur et la statue de la Vierge fut transférée dans l'ancien petit chœur.
En 1948 Mgr. Weber présida les fêtes du 500e anniversaire du pèlerinage, et le 3 septembre 1961 Mgr. Elchinger, coadjuteur, celles du 150e anniversaire de la Translation de la statuette, devant près de 1000 pèlerins.
La chapelle latérale reçut en 1954 de nouveaux vitraux réalisés par l'artiste Kempf de Colmar et dont l'un représente Notre-Dame du Schauenberg au Congo, église bâtie par Mgr. Biechy, évêque missionnaire originaire de Hattstatt, particulièrement assisté par N.-Dame du Schauenberg en Alsace.
Ces
vitraux, exécutés d'après les dessins de
l'artiste colmarien Robert
Gall, furent la dernière œuvre de l'artiste
Kempf.
A
l'extérieur de la chapelle un autel en
pierre a été érigé au printemps
1961 par un groupe de volontaires et a été inauguré le lundi
de Pâques de la même année par une messe
Solennelle. Mgr.
Mbemba, archevêque de Brazzaville, ancien
curé de N.- Dame du
Schauenberg au Congo, rend à son tour visite
à N.-Dame du
Schauenberg en Alsace et y chante une
grand'messe solennelle
le 23 septembre 1962.Son successeur, Mgr
Biayenda, sacré évêque à Rome, Pentecôte
1970, y passa à son tour. Il mourut
assassiné, à Brazzaville en 1977.
La rénovation de l'ancien couvent.. L'ancienne résidence des Franciscains était dans un état de délabrement tel qu'on ne pouvait la sauver que par une rénovation totale. Cette lourde tâche incomba à Mr. le Curé Kueny de Pfaffenheim. Dès 1960 les plans furent dressés, mais le chantier ne fut ouvert qu'en novembre 1963. Malgré de sérieuses difficultés, les gros travaux purent néanmoins être achevés début octobre 1964 grâce aux efforts conjugués de M. Jean Schellenbaum, agent technique, qui établit bénévolement les devis, de nombreux ouvriers volontaires de la paroisse et d'une équipe de trois maçons italiens sous la direction d'un chef de chantier. En même temps fut aménagée une belle route avec Parking permettant aux voitures d'accéder au pèlerinage.
Rénovation de la
chapelle. Ce fut
ensuite le tour de la chapelle qui n'avait
plus connu de retouche
depuis plus d'un demi siècle et dont
l'intérieur était tout
noir. Grâce à
une grande tombola lancée durant l'été pour
sa restauration, le nouveau chantier put être
ouvert en décembre 1966.L'architecte Schaeck
de Strasbourg dirigea les travaux entrepris par
l'entreprise Penserini de Hattstatt et bien
des ouvriers bénévoles. On enleva le plafond
en plâtre, ce qui permit la remise en
valeur des vieilles poutres encore bien
conservées et datant
de 1810. Les murs furent recouverts par une terrasite blanche,
tandis qu'était installé le chauffage à air
pulsé.
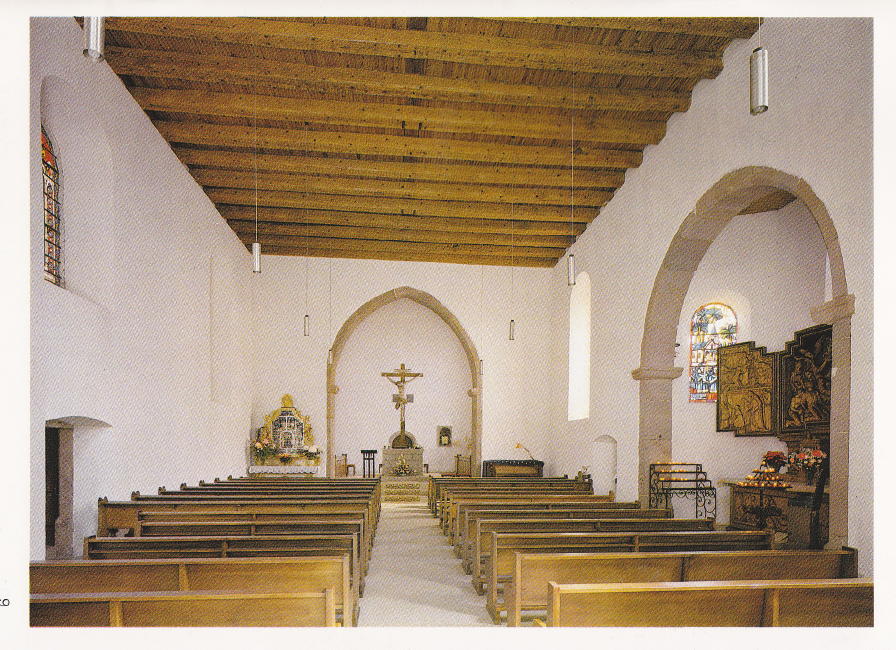
Au
milieu du chœur on plaça l'autel face au
peuple conformément au
renouveau liturgique. La fenêtre du mur
central du
choeur fut supprimée et le mur se trouve
ainsi dégagé, mettant bien en valeur la
porte voûtée. Il restait à éloigner les
autels latéraux dépourvus de valeur
artistique, l'inesthétique tribune avec son orgue
en fort mauvais état et trop coûteux pour
pouvoir être rénové ainsi que les quelques
bancs branlants. Des prie-Dieu offerts de
différents côtés meubleront la chapelle en
attendant d'être remplacés en 1981 par une
première série de bancs massifs en chêne et
en bon état offerts par la Maison des P.
Rédemptoristes d'Ostwald, bancs qu'elle-même
s'était vue offerts par l'église Saint
Pierre le Vieux de Strasbourg. Une deuxième
série quasi à l'état neuf, offerte en
octobre 1983 par Maison-Mère des Sœurs de St
Marc de Colmar,vint compléter l'ameublement
de la chapelle en bancs. Des confessionnaux
neufs furent installés
dans niche du côté
du rocher.
A présent l'intérieur du sanctuaire offre un
aspect grandiose par sa simplicité. La
statue miraculeuse occupe une place digne
d'elle à l'entrée du choeur. Les ex-voto les
plus anciens sont groupés sur le mur du
fond. Pendant l'exécution des travaux, on
fit dans le mur central l'heureuse
découverte d'une custode en pierre, elle
sert désormais de tabernacle.
Pendant l'exécution des travaux, on fit dans
le mur central du choeur l'heureuse
découverte d'une custode en pierre, elle
sert désormais de tabernacle.
L'ensemble est rehaussé par
l'imposant Christ en bois qui domine l'autel
face au peuple. Ce calvaire, jadis placé le
long d'un chemin de procession à l'entrée de
la forêt est une sculpture impressionnante
qui remonte probablement au XVII° siècle.
A présent l'intérieur du
sanctuaire offre un aspect grandiose par sa
simplicité. La statue miraculeuse occupe une
place digne d'elle à l'entrée du chœur d'où
elle nous envoie au Seigneur.
 L'intercession
de la Vierge. Les ex-voto qui
parlent de l'intercession de la Vierge sont
nombreux. Ce sont de petits tableaux sans
grande valeur artistique, mais combien
touchants, ou des plaques en marbre. La
présence de certaines notes dans les
Archives et l'organisation de processions
prouvent également le recours à la Vierge
miraculeuse.
L'intercession
de la Vierge. Les ex-voto qui
parlent de l'intercession de la Vierge sont
nombreux. Ce sont de petits tableaux sans
grande valeur artistique, mais combien
touchants, ou des plaques en marbre. La
présence de certaines notes dans les
Archives et l'organisation de processions
prouvent également le recours à la Vierge
miraculeuse.
Ainsi le " Neues Schauenberg-Büchlein" (1833)
relate que, lors de la Translation de 1811,
une jeune fille de Rouffach aurait fait une
chute grave du haut d'un rocher sans se
blesser, qu'une personne de Pfaffenheim fut
guérie dans la chapelle même
en 1823. La chronique paroissiale cite
d'autres cas de protection ou de guérison.
Depuis 1828, des ex-voto furent placés au
fond de la chapelle: on y voit décrite la
protection de personnes tombées d'un arbre
ou d'un toit, d'autres sauvées d'un torrent,
protégées pendant un naufrage en
Amérique, dans un incendie dans un
accident de chemin de fer ou au cours d'une
maladie grave. A
côté de ces tableaux d'un art populaire, des plaques de marbre
proclament l'assistance particulière de la
Vierge. Il y a aussi
la procession des foules pérégrinant vers ce
lieu de prière :
une procession de Pfaffenheim promise
pendant que la peste
sévissait en 1661 fut organisée le 28
décembre. Une autre vient de Soultzmatt et tient son origine du choléra
de 1854 sans oublier
celles conjuguées de Rouffach et de
Pfaffenheim pendant les
grandes sécheresses ou les pluies
désastreuses, l'ancienne procession de
 Westhalten, celle des fidèles
de Turckheim en 1655,
toutes celles enfin qui furent organisées au
lendemain des guerres.
Rouffach organise depuis 1945 une telle
procession le jour de
l'Ascension. Il
est à noter que la plupart de ces
processions sont abandonnées la nouvelle
route favorisant l'accès au pèlerinage aux
moyens de locomotion moderne.
Westhalten, celle des fidèles
de Turckheim en 1655,
toutes celles enfin qui furent organisées au
lendemain des guerres.
Rouffach organise depuis 1945 une telle
procession le jour de
l'Ascension. Il
est à noter que la plupart de ces
processions sont abandonnées la nouvelle
route favorisant l'accès au pèlerinage aux
moyens de locomotion moderne.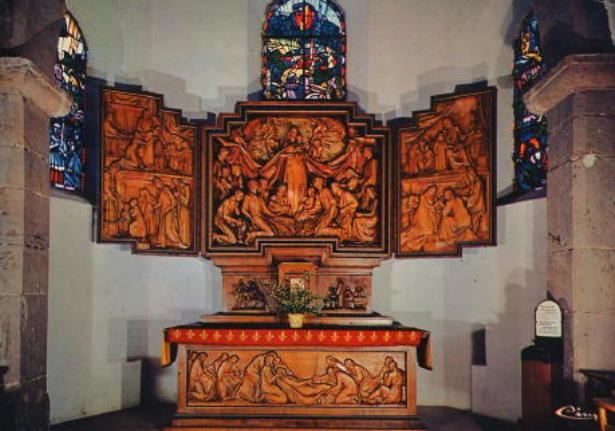 atéral: la partie la
plus ancienne de la chapelle où un pilier
gothique porte le millésime 1607.
atéral: la partie la
plus ancienne de la chapelle où un pilier
gothique porte le millésime 1607.
La partie centrale du triptyque représente
Notre-Dame prenant sous son manteau tous les
hommes quel que soit leur état de vie et
chacun peut s'y retrouver. Nous voyons de
gauche à droite: le personnel enseignant, le
mineur, le paysan, la maman avec l'enfant,
le vigneron, l'ouvrier, la Soeur
garde-malade avec le malade, la jeune fille
et le prêtre, tous, le regard tourné vers
Marie. Sur les volets ouverts sont sculptées
différentes scènes de la vie de la Vierge
qui se terminent tout en bas avec la
Dormition.
L'accueil du
pèlerin. Dès 1964 la restauration
de l'ancien couvent permit la création d'une
belle salle d'accueil pour environ 80
personnes. Elle s'avéra vite trop petite vu
le nombre grandissant des pèlerins.
La commune, renonçant à rénover la maison
trop délabrée du garde-forestier, préféra en
bâtir une nouvelle au village même où le
garde emménagea en octobre 1976, libérant
ainsi les lieux. Avec l'accord de la
Municipalité et moyennant le franc
symbolique tout l'ensemble revint au
pèlerinage qui, sous la gestion de la
Fabrique de l'Église sera chargé de veiller
sur ces bâtiments.
Dès janvier 1978, grâce aux plans de notre
fidèle technicien Jean Schellenbaum et avec
le permis de construire vite accordé,
s'ouvrit un nouveau chantier de restauration
et de transformation. De ce que fut
l'ancienne ferme: écurie, grange avec tout
le reste du parterre, surgit une salle
spacieuse et très accueillante pour environ
150 pèlerins. Elle fut inaugurée par Mgr.
Brand, évêque auxiliaire le lundi
de Pentecôte 4 juin 1979. La cuisine fut
également bien aménagée, ce qui permettra de
servir des repas simples à des groupes
organisés de pèlerins, s'ils le désirent. La
première salle d'accueil de l'ancien couvent
servira désormais de lieu de conférence les
jours de récollection ou de travail en
groupe. Liberté entière est donnée
d'apporter et de consommer son pique-nique
sur place. La salle ainsi que la licence
offerte gracieusement par l'ancien
restaurant Flesch Joseph sont avant tout là
au service du pèlerin et non l'inverse.
Abords rénovés.
Début février 1980 nous attendait une
désagréable surprise: ce fut l'écroulement
du mur en face de l'ancienne maison
forestière. Grâce à la générosité des
pèlerins et à l'aide de bien des ouvriers
bénévoles et aussi celle de la commune, un
tour de force fut réalisé. Un mur nouveau
plus solide permettant d'aménager une cour
plus spacieuse avec dallage put être
inauguré le lundi de Pentecôte de la même
année.
L'hiver très rude 1981 —82 faillit nous
ménager la même surprise pour le grand mur
de soutènement en face de la chapelle. La
canalisation et la pose d'un dallage dans
une solide couche de béton pour empêcher les
infiltrations vont rétablir la situation et
aussi sauver le mur des pluies diluviennes
de l'année suivante, mai 1983, où un
glissement de la montagne elle-même menaça
l'église de Gueberschwihr.
Le Schauenberg:
Voies d'accès et excursions. Une
belle route, terminée le 1 octobre 1964,
remplace le chemin qui existait auparavant,
elle serpente par le vignoble et la forêt
jusqu'au Parking, à proximité de la
chapelle. D'autre part, des chemins bien
signalisés relient Westhalten. Rouffach et
Gueberschwihr au Schauenberg. De celui-ci un
sentier forestier passe par les "rochers
coucou" (Kuckuck-stein) jusqu'à la Maison
forestière et au Couvent de St Marc d'où
l'on peut redescendre à Gueberschwihr. Une
excursion plus longue: de St Marc par
Osenbuhr à Osenbach et à Soultzmatt ou de St
Marc par le Staufen aux Trois châteaux
d'Eguisheim et à Eguisheim. Près de la
chapelle des conglominets(?): rochers
importants.
En conclusion.
Voici relatée l'histoire du Schauenberg tel
qu'il se présente en ce 5ème centenaire de
son érection en chapellenie par l'Évêché de
Bâle.
C'est grâce à la compréhension de la commune
de Pfaffenheim, grâce à tant de travail
bénévole de la part de paroissiens de
Pfaffenheim, grâce à l'apport matériel en
offrande de la part de nombreux et fervents
pèlerins et certainement aussi et avant tout
grâce à leur prière que ce chantier a pu
être mené à bonne fin et sans le moindre
accident. Qu'il soit permis au prêtre qui a
eu le bonheur de se trouver à la tête de
cette restauration de remercier cordialement
tous ceux qui lui ont fait confiance, l'ont
aidé et soutenu, c'est ensemble que nous
avons pu réaliser tout cela et donner au
Schauenberg l'aspect rajeuni et accueillant
qu'il présente à présent. Qu'il soit aussi
rappelé que tout cela a été fait dans le but
primordial de garder au Schauenberg son
caractère de pèlerinage et de prière. C'est
à vous,
paroissiens de Pfaffenheim et à vous tous,
pèlerins fervents, que la garde de ce lieu
est confiée. Venez y prier avec confiance
et, dans ce climat de recueillement,
sentez-vous bien chez vous aux pieds de
Notre-Dame du Schauenberg! Veillez à ce
qu'il demeure fidèle à sa mission de
haut-lieu de prière!
P. Stintzi
S. Kueny
Bibliographie: Léon Josbert,
Geschichte der Walifahrt und des
Walifahrtsortes in ,,Maria Hilf auf dem
Schauenberg" mit eingehender Bibliographie,
Mulhouse 1932. — Paul Stintzi: Schauenberg
bei Pfaffenheim. — Almana franciscana
antiqua VII (mit Bibliogr.). — Pfarr-
Archiv Pfaffenheim Bulletin Paroissial No.
72 octobre 1964 et No. 117, octobre 1968.
No. 235—236 Juin — Juillet 1979 No. 245 Mai
1980; No. 264 et No. 265 Mars — Avril 1982.
Schnell, Guide d'art No 921 (1969) 2ème
édition 1984
VERLAG SCHNELL & STEINER GMBH & CO. / MUNICH
ET ZURICH
D-8000 Munich 65. BP 112 • Impression:
Erhardi Druck Gmbh), Regensburg (Ratisbonne)
Liste des immeubles protégés au titre de la législation sur les
monuments historiques au cours de
l’année 2000
NOR : MCCE0100151K
(extrait)
Pfaffenheim. - Chapelle Notre-Dame du Schauenberg
(CAD 24 25) : inscription par arrêté du 25 février 2000.
______________________________________
*
Le nom de Schauenberg:
Certains documents rapportent qu'en 1400 les
habitants de la plaine virent, sur la hauteur au pied de
laquelle se trouve Pfaffenheim, une lueur éclatante qui disparut
graduellement sans laisser de traces. À partir de ce temps, la
montagne,
qui s'était jusqu'alors appelée
Hohburg ou
Hohenbourg, fut
désignée sous le nom de Schauenberg.